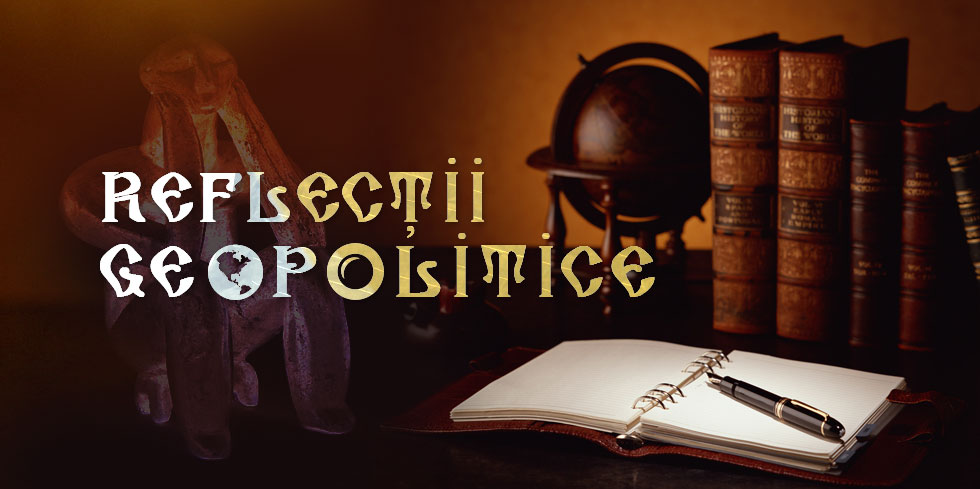Environ 50 000 anciens membres de l’État islamique (EI) et leurs familles sont actuellement détenus dans 27 prisons et centres de détention à travers le Nord-Est de la Syrie. Ils ont été les théâtres, au fil des années, de tentatives d’évasion, dont certaines ont abouti à la libération de djihadistes qui sont ensuite venus renforcer les rangs du groupe terroriste.
L’administration Trump a réduit de 117 millions de dollars l’aide humanitaire destinée aux camps de détention dans le Nord-Est de la Syrie. Ces coupes budgétaires concernent entre autres des financements qui avaient été alloués à la gestion de services essentiels des camps, notamment la collecte de données et l’analyse des bases de données sécuritaires. Dans le même temps, l’administration envisage de réduire sa présence militaire dans le Nord-Est syrien, passant d’environ 2 000 forces d’opérations spéciales à environ 700. Ces réductions, tant en matière de financement que de personnel, risquent de produire des effets déstabilisateurs de deuxième et de troisième ordre, dont les répercussions se feront sentir non seulement en Syrie, mais dans l’ensemble de la région, touchant les alliés et les intérêts américains au Moyen-Orient.
Ces prisons et centres de détention sont de véritables foyers d’extrémisme et de radicalisation. Ils constituent depuis longtemps une cible de choix pour l’État islamique, dont les combattants ont tenté à plusieurs reprises des attaques spectaculaires, certaines ayant réussi à libérer des détenus qui ont ensuite réintégré les rangs djihadistes. Afin de prévenir une catastrophe prévisible, les États-Unis, leurs alliés occidentaux, ainsi que leurs partenaires moyen-orientaux – y compris les États du Golfe et d’autres acteurs engagés dans la stabilisation de la Syrie – devraient s’efforcer d’améliorer les conditions de vie dans ces camps. Dans le même temps, cette coalition d’acteurs doit mobiliser ses leviers politiques et économiques pour accélérer le processus de rapatriement des ressortissants étrangers, en incitant les pays à surmonter le manque de volonté politique et les autres obstacles qui freinent le retour des détenus dans leurs pays d’origine. Plus ces problèmes demeurent sans solution, plus le risque grandit de voir survenir une évasion massive qui, en plus de regonfler les effectifs de l’État islamique, constituerait un atout considérable pour sa propagande et ses opérations d’influence.
L’État islamique n’a pas disparu
Ces coupes budgétaires interviennent alors même que l’État islamique connaît une résurgence en Syrie. En 2024, l’organisation a mené environ 700 attaques contre des cibles en Syrie, soit trois fois plus que les années précédentes, tout en augmentant leur létalité, leur sophistication et leur exécution. Début mars, les États-Unis ont soutenu les Forces démocratiques syriennes dans la capture du dirigeant de l’État islamique Salah Mohammad al-Abdullah à Al-Chahil, en Syrie. Fin mai également, les forces américaines ont participé à six opérations distinctes contre l’État islamique, dont cinq en Irak et une en Syrie. Au total, deux membres de l’organisation ont été tués, deux autres arrêtés (dont un haut responsable) et plusieurs arsenaux d’armes ont été saisis.
Bien que les attaques aient diminué au premier trimestre 2025, l’État islamique observant le nouveau gouvernement du président Ahmed al-Charaa, elles ont fortement augmenté depuis le début du retrait des forces américaines en avril, pour atteindre une moyenne de 14 assauts par mois en avril et en mai. Fin juillet, les forces américaines ont tué un haut dirigeant de l’État islamique, Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani, ainsi que ses deux fils adultes. Le même mois, les forces kurdes syriennes ont annoncé l’arrestation de neuf membres de l’organisation et d’un trafiquant de drogue lors d’opérations distinctes menées dans la ville de Raqqa et sa campagne, dans le Nord de la Syrie.
L’État islamique n’a pas disparu ; il est entré dans une nouvelle phase de reconstruction. Washington doit donc maintenir la pression sur l’organisation. Dans le cas contraire, celle-ci disposerait d’une occasion en or pour recruter de nouveaux membres, élaborer une stratégie viable sur le long terme et reprendre l’offensive, déstabilisant le gouvernement de Damas et risquant de replonger la Syrie dans la guerre civile. Une nouvelle vague de violence, en particulier confessionnelle, pourrait attirer un afflux de combattants terroristes étrangers, de la région et d’ailleurs, aggravant une situation déjà fragile et offrant à l’État islamique un vivier renouvelé de recrues.
Objectif : évasions
L’État islamique a fait de la libération de ses membres détenus par les Forces démocratiques syriennes (FDS) une priorité. Le groupe a mené des attaques répétées contre des établissements pénitentiaires, notamment lors de l’évasion de la prison Al-Sina’a à Hassaké en 2022, où étaient détenus entre 3 000 et 5 000 combattants de l’État islamique. Il a fallu six jours pour repousser l’attaque et les forces américaines ont soutenu leurs alliés des FDS durant cette opération. Une réduction de la présence américaine amoindrirait les capacités de réponse à certaines questions de sécurité parmi les plus pressantes en Syrie.
Nulle part les dommages potentiels causés par les coupes budgétaires américaines ne sont plus manifestes que dans les camps de détention. Les réductions de l’USAID ont touché 15 projets au camp d’Al-Hol et 5 projets au camp de Roj. Alors que les FDS détiennent environ 8 500 hommes et adolescents étrangers, irakiens et syriens dans deux douzaines de prisons, Al-Hol et Roj abritent respectivement 36 000 et 2 400 personnes déplacées. Ces occupants, majoritairement des femmes et des enfants, comprennent 15 000 Irakiens et 8 000 ressortissants étrangers originaires de 60 pays.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a considére que les conditions à Al-Hol entravaient la survie même des personnes qui y sont détenues. Un rapport des Nations unies de 2023 fait état d’égouts à ciel ouvert, de logements inadaptés, d’un accès limité aux besoins essentiels, ainsi que de violences et d’agressions sexuelles récurrentes. Parmi les détenus d’Al-Hol et Roj, respectivement 60 % et 63 % sont des enfants. Des cellules de l’État islamique sont actives dans l’ensemble du camp d’Al-Hol, mais particulièrement dans l’« Annexe », qui regroupe les détenus étrangers non irakiens.
Afin d’éviter un possible recrutement par l’État islamique, les FDS ont commencé à séparer les fils de leurs mères lorsqu’ils atteignent l’adolescence, les envoyant dans des prisons où ils sont gardés au secret. Ces séparations arbitraires provoquent des épidémies d’anxiété sévère aussi bien chez les mères que chez les fils, tout en ayant peu d’effet sur la diminution des sympathies envers l’État islamique au sein de l’« Annexe ». Les coupes budgétaires ont aggravé une situation déjà intenable, laissant à l’État islamique l’opportunité de combler le vide ainsi créé.
Ce qu’il convient de faire
La menace posée par l’État islamique, les tentatives répétées d’évasions et les conditions favorisant la radicalisation soulignent la nécessité d’investir dans la mise en œuvre de plans de rapatriement. Trente-six pays ont déjà rapatrié au moins une partie de leurs ressortissants, tandis que vingt-et-un autres n’ont pas encore entamé le processus.
Le pays dont l’effort est le plus remarquable est l’Irak. À la mi-août 2025, il avait rapatrié 25 000 de ses ressortissants, soit environ 80 % de la population irakienne présente à Al-Hol et Roj. Dans un communiqué sur X, le Commandement central américain a salué les efforts irakiens, affirmant qu’ils témoignent de l’engagement du pays envers la « défaite durable de l’EI ». Le Bureau de lutte contre le terrorisme du département d’État a également félicité le Kosovo, le Kazakhstan, la Macédoine du Nord, l’Albanie, le Soudan, le Kirghizstan et la Barbade pour leurs progrès dans le rapatriement de leurs ressortissants. Les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Malaisie et la Russie progressent également.
Après une pause de cinq ans et de multiples retards, l’Indonésie n’a toujours pas commencé à rapatrier ses plus de 400 ressortissants présents à Al-Hol et Roj. Le Bureau indonésien de lutte contre le terrorisme, les organisations issues de la société civile et les gouvernements locaux sont prêts à accueillir ces rapatriés, mais attendent l’approbation des autorités gouvernementales. Le Royaume-Uni s’est montré particulièrement réticent à rapatrier ses ressortissants et a privé certains d’entre eux de leur citoyenneté. Bien que cette mesure puisse sembler une option viable, elle peut avoir des conséquences négatives sur la sécurité nationale, laissant ces ressortissants apatrides à Al-Hol, sans autre choix que de rejoindre l’État islamique.
Les États-Unis restent engagés à soutenir les pays qui cherchent à rapatrier leurs citoyens. Les organisations internationales jouent également un rôle clé, reconnaissant que la déchéance de nationalité ne désamorce pas la menace que représente l’État islamique dans les camps. De nombreuses organisations internationales soutiennent les efforts nationaux de rapatriement. Le CICR collabore avec les pays pour identifier leurs ressortissants à Al-Hol et Roj. Le Global Community Engagement and Resiliency Fund soutient les programmes de retour dans plus d’une demi-douzaine de pays et met en œuvre un programme préparant les femmes et les enfants à revenir dans leur pays d’origine grâce à l’éducation et à un accompagnement psychologique. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) participent à des activités de plaidoyer pour renforcer l’engagement des gouvernements en faveur des besoins des femmes et enfants revenant de Syrie. Ces agences interviennent concrètement sur le terrain, l’UNICEF conseillant sur les lignes directrices de réhabilitation des enfants et l’ONUDC formant les psychologues et travailleurs sociaux locaux.
Ces efforts doivent se poursuivre. Chaque année qui passe, les jeunes d’Al-Hol et Roj grandissent ; les adolescents passent plus de temps en prison, loin de leurs mères et sœurs ; les traumatismes s’accumulent ; les déficits de santé et d’éducation se multiplient ; et la charge du rapatriement s’alourdit. Pendant ce temps, l’État islamique continue de recruter à Al-Hol, Roj et dans les prisons où sont détenus les jeunes hommes. Le rapatriement sera sans doute une tâche complexe et coûteuse. Pour autant, si les investissements appropriés sont réalisés et que les États et organisations internationales soutiennent ces efforts, les femmes et les enfants pourront être (ré)intégrés avec succès, Al-Hol et Roj pourront être fermés, et l’État islamique sera privé d’un vivier de recrues.