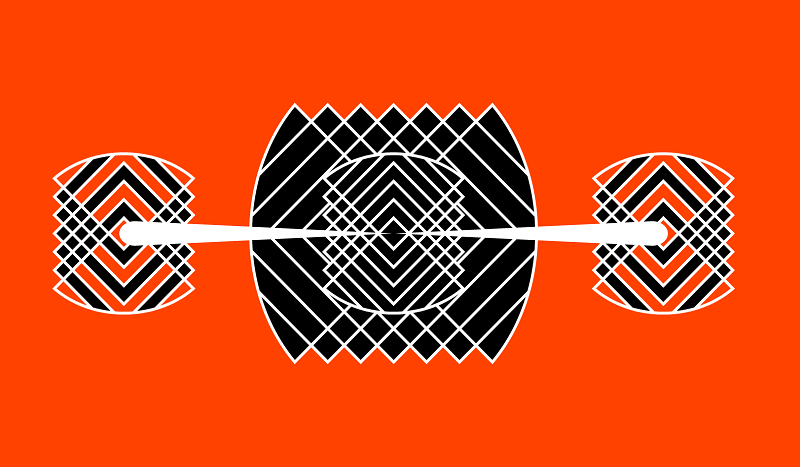
Depuis 2019, l’initiative Technopolice documente et analyse le déploiement illégal des technologies d’intelligence artificielle qui cherchent à augmenter la puissance policière de répression dans l’espace public. En quatre ans, ces technologies se sont perfectionnées et leurs promoteurs – des entreprises et des représentants de politiques sécuritaires – tentent de sortir de cette position illégale inconfortable.
Alors que le déploiement de ces IA policières s’est fait dans l’illégalité la plus totale, la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a précisément pour but d’amorcer cette légalisation de la surveillance biométrique, en commençant par la VSA : la vidéosurveillance algorithmique. Mais pour arriver jusqu’ici, l’industrie a déployé tout un panel de stratégies pour rendre ces technologies acceptables. Décortiquons-les.
Panorama des technologies phares de surveillance biométrique
Tout d’abord, rappelons la véritable nature des trois technologies phares des entreprises du marché de la surveillance biométrique, qui mêlent captation de nos attributs (couleur des vêtements, sacs, couvre-chefs, etc.), de nos caractéristiques physiques (formes de nos corps, démarche…) et intelligence artificielle.
VSA
La vidéosurveillance algorithmique consiste en l’automatisation du travail d’analyse des images de vidéosurveillance grâce à un logiciel, basé sur des algorithmes de « computer vision » (le champ de l’intelligence artificielle spécialisé dans le traitement des images), qui se charge de produire des notifications lorsque qu’il détecte un événement qu’on l’a entraîné à reconnaître, généralement en vue d’une intervention policière. Cette technologie est aussi utilisée pour des usages privés, par exemple pour détecter des intrusions dans une propriété privée ou pour surveiller les clients des supermarchés.
Les algorithmes ayant pour but de reconnaître une information sur une image sont généralement basés sur de l’apprentissage automatique, aussi appelé « machine learning ». Pour pouvoir faire de la reconnaissance sur ces flux vidéo, il convient de traduire des informations (nombre de pixels, position, couleur, et leur évolution dans le temps) en informations statistiques plus intelligibles et manipulables qu’on appelle des caractéristiques.
Nous avons recensé de manière non exhaustive la mise en place de cette technologie dans plus de 200 villes françaises. Par exemple, la VSA peut détecter des « évènements anormaux » qui sont en réalité des comportements anodins tels que des rassemblements ou le fait d’être statiques, mais aussi suivre le parcours d’une personne ou lire des plaques d’immatriculation.
ASA
L’audiosurveillance algorithmique fonctionne de la même manière que la VSA mais en utilisant des signaux audio à la place des flux vidéo. Contrairement à la VSA, qui se base sur le parc de vidéosurveillance existant, cette technologie demande d’installer des micros dans les rues. La première ville dans le viseur des collectifs luttant contre la technopolice a été Saint-Étienne, où, sous couvert d’expérimentation la municipalité avait prévu d’installer plusieurs dizaines de capteurs sonores dans un quartier de la ville afin d’en traquer les « bruits suspects » (klaxons, bris de verres, bombes aérosols)… Dès 2019, nous avions pu analyser la gravité du projet qui a finalement été annulé suite à une grande mobilisation des Stéphanoi·ses et un avertissement de la CNIL.
Cela n’a pas empêché la ville d’Orléans de lancer un projet similaire en 2021, contre lequel La Quadrature a déposé un recours, toujours en cours d’examen par le tribunal.
Reconnaissance faciale
La reconnaissance faciale fonctionne grâce aux mêmes algorithmes de « computer vision » que la VSA, c’est à dire de l’apprentissage statistique qui a pour but d’analyser et déterminer les corrélations et paramètres identiques entre des images. Dans cette application là, les algorithmes sont circonscrits aux traits du visage, on peut donc considérer la reconnaissance faciale comme une sous-catégorie de la VSA.
En France, la reconnaissance faciale est déjà massivement utilisée par la police à travers le fichier de police du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Dans ce cadre, la reconnaissance faciale est utilisée pour créer un lien direct entre le visage d’une personne et son identité civile enregistrée dans le TAJ. Cet usage permet aux agents de comparer, a posteriori, des images de vidéosurveillance ou de réseaux sociaux avec plus de huit millions de photos de personnes contenues dans ce fichier.
De plus, nous avons pu observer plusieurs tentatives d’installation de la reconnaissance faciale dans l’espace public en France. Par exemple, la région PACA a voulu mettre en place des portiques de reconnaissance faciale dans deux lycées, à Nice et à Marseille en 2018. Nous avons fait un recours et le dispositif a été jugé illégal en 2020, car totalement disproportionné, par le Tribunal administratif de Marseille et par la CNIL.
Les entreprises qui proposent des solutions de VSA sont tout autant en mesure de faire de la reconnaissance faciale. Officiellement, la plupart d’entre elles affirment ne pas utiliser les caractéristiques biométriques propres au visage car cela les ferait souffrir d’une trop mauvaise publicité, due au rejet massif de la reconnaissance faciale dans la société. Pourtant, elles utilisent bien d’autres caractéristiques biométriques (analyse des corps et de leurs mouvements) qui leur permettent de vendre leurs outils de VSA aux municipalités. De plus, nombre de ces entreprises proposent conjointement la VSA et la reconnaissance faciale dans leurs services, c’est le cas par exemple de Atos, Idemia, Thales, Axis, Avigilon ou encore Two-I.
Nous dénonçons depuis longtemps le lien étroit entre toutes les technologies de surveillance biométrique. Si la VSA venait à être légalisée, les promoteurs de la reconnaissance faciale n’auraient plus qu’à expliquer qu’elle est seulement une application particulière de la VSA pour la faire accepter à son tour, comme un prolongement naturel ou logique. En autoriser une, c’est les accepter toutes, il est donc extrêmement important de ne laisser aucune de ces technologies gagner du terrain.
Les stratégies d’acceptation et de légalisation de la surveillance biométrique
Le droit actuel fournit une large protection des données personnelles et particulièrement des données biométriques. Nous l’expliquions dans cet article, avec le RGPD et la directive Police-Justice, la surveillance biométrique est pour l’heure strictement illégale. Les promoteurs de la surveillance biométrique sont au fait de cette illégalité. Pour contourner cet obstacle juridique, ils utilisent plusieurs stratégies pour faire exister ces technologies, les rendre acceptables et, in fine, les légaliser.
Comme ces technologies sont déployées en toute opacité, obtenir des informations sur ces stratégies nous a demandé d’employer divers moyens : demandes d’accès à des documents administratifs (pour les appels d’offre et les procès-verbaux de conseils municipaux par exemple), analyse de la communication des entreprises ou réception d’informations par des lanceurs d’alertes (notamment par notre plateforme de leak sécurisée). Récemment, nous avons aussi obtenu auprès de la CNIL les réponses des entreprises à la consultation qu’elle avait lancée il y a un an sur le sujet, que nous citons et publions ici, tant celles-ci sont l’illustration patente de ces techniques d’acceptabilité1.
L’expérimentation : faire croire à la surveillance éphémère
L’expérimentation a été une des premières stratégies mises en œuvre pour confronter les publics à la surveillance biométrique et ainsi les habituer à cette technologie. L’appellation d’« expérimentation » permet de donner un sentiment d’éphémère et de réversibilité de leur mise en place.
Dès 2018, nous avons assisté à une tentative d’installation de portiques de reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées à Nice et à Marseille, sous couvert d’expérimentation. De même, la ville de Nice a expérimenté un système de reconnaissance faciale en 2019 lors de son carnaval, expérimentation dont les résultats n’ont jamais été objectivement communiqués.
Pour justifier la violation du RGPD et de la directive Police-Justice, les arguments consistaient à dire que l’expérience de reconnaissance faciale était « limitée dans le temps » et fondée sur le consentement explicite de volontaires. Cette stratégie se résume à faire exister des projets de surveillance biométrique en les « adoucissant » grâce à l’image expérimentale et permet aux promoteurs de la surveillance biométrique d’ancrer ces technologies sur le territoire, de les rendre normales dans nos environnements. Une fois que ces technologies ont une existence physique, il est beaucoup plus facile de les pérenniser et donc de justifier leurs légalisations.
Un grand nombre d’entreprises poussent cette stratégie dans les réponses à la consultation de la CNIL. Par exemple le lobby de la vidéosurveillance AN2V(l’Association Nationale de la « Vidéoprotection ») plaide pour un « droit à l’expérimentation » quand l’entreprise Deveryware juge que « les tests grandeur nature constituent également une nécessité pour vérifier la robustesse du produit, son efficacité et son efficience ».
On retrouve exactement le même procédé d’acceptabilité dans le projet de loi sur les Jeux olympiques, celui-ci prévoyant une « expérimentation » dans les évènements récréatifs, sportifs et culturels. Le gouvernement peine à masquer les volontés d’installer la VSA dans le quotidien puisque cette « expérimentation » durerait quasiment deux ans !
La dialectique du progressisme contre les réactionnaires
Les technologies de surveillance biométriques sont fondées sur des algorithmes de « machine learning » dont l’existence est assez récente et qui sont très en vogue, y compris en dehors de l’industrie de la surveillance. Ils incarnent donc la nouveauté, le progrès et un futur soi-disant « inéluctable ». De nombreuses villes, y compris de très petites communes – comme Moirans en Isère – veulent l’adopter pour se donner une image de progrès et de modernité. Couplé à la stratégie d’expérimentation, il est assez facile pour ses promoteurs de présenter les militants s’opposant à la surveillance biométrique comme des réactionnaires souhaitant « revenir en arrière », alors même que ceux-ci ne font que réclamer la suspension de projets illégaux et présentés initialement comme éphémères.
Pour mettre en avant ces bienfaits, les entreprises s’arment d’un discours publicitaire toujours plus valorisant à l’égard de leurs produits en les présentant comme très efficaces, voire « technomagiques », pour résoudre tout type de problème. Ainsi, dans les réponses à la CNIL, un grand nombre d’acteurs présentent la VSA comme ayant des bénéfices « évidents » pour la sécurité et arguent que les refuser serait préjudiciable pour la société. Pourtant l’évidence de ces bénéfices n’est jamais démontrée.
Pour l’Union des Transports publics et Ferroviaires (qui voit dans la VSA un « bien commun », le chargé d’affaires publiques était manifestement très inspiré), « le déploiement de nouveaux systèmes de vidéos augmentées est important : il offre une nouvelle capacité d’anticipation et de réaction des opérateurs de service public non seulement en adéquation avec les réalités de fonctionnement du quotidien en matière de transport de masse, mais aussi, en adéquation avec les risques de notre temps et les attentes de « mieux vivre ensemble » du citoyen-voyageur ».
Pour l’entreprise Idemia (leader du marché de la reconnaissance faciale), l’intérêt de la vidéosurveillance est « indiscutable » car la VSA « permettrait de réduire le nombre d’agents chargés de l’exploitation des flux des caméras (…) au bénéfice d’agents sur le terrain, plus vite (stratégie des feux naissants) et donc plus directement au service des citoyens ». L’entreprise prétend même que les biais algorithmiques – par leur nature supposée quantifiable et maîtrisable – seraient moindres que les biais humains. Cela l’amène à rêver de « salles vidéo aux écrans éteints, et donc une liberté d’aller et de venir retrouvée » car « chaque caméra aura alors l’efficacité d’une patrouille expérimentée, sans avoir les dérives potentielles [des biais humains] ».
Ce discours péremptoire et mensonger de l’industrie – la VSA aurait un « intérêt indiscutable », serait du « bien commun », permettrait de « mieux vivre ensemble », etc. – ne s’accompagne d’aucune étude, d’aucune preuve, il s’agit simplement d’un discours publicitaire qui se retrouve pourtant bien souvent repris sans être questionné par des représentants politiques voulant démontrer qu’ils agissent pour la « sécurité ».
La hiérarchisation : accabler une technologie pour faire accepter les autres
Une autre stratégie utilisée par les promoteurs de la surveillance biométrique est de mettre en concurrence la capacité d’atteinte aux libertés des différents outils de surveillance biométrique pour en présenter certaines comme inoffensives. Tout l’enjeu de cette stratégie est de hiérarchiser ces technologies – pourtant toutes considérées comme illégales par le RGPD et la directive Police-Justice – afin de jeter l’opprobre sur certaines et ainsi maintenir les autres dans l’opacité pour en cacher la gravité. Les entreprises de l’industrie de la surveillance biométrique entendent par cette rhétorique contribuer à dessiner la ligne d’un soi-disant « garde-fou » tout en se donnant l’image de se préoccuper des libertés alors qu’elles sont en réalité en train de les piétiner.
La reconnaissance faciale est alors un outil stratégique très utile. Bien connue et depuis longtemps car très représentée dans la fiction dystopique, elle évoque instantanément la surveillance de masse : elle est dans l’imaginaire collectif la « ligne rouge » à ne pas franchir. Conscientes de cela, les entreprises tentent de créer une différenciation entre la reconnaissance faciale, dangereuse, et les autres technologies de surveillance biométrique – l’ASA et la VSA – qui seraient beaucoup moins graves en comparaison, et donc acceptables.
Le choix des mots utilisés pour nommer et décrire ces technologies représente un enjeu stratégique majeur pour leur acceptabilité par la population. Chaque entreprise développe donc tout un discours marketing mélioratif et dédramatisant visant a éclipser le caractère biométrique de leur surveillance et à le présenter comme moindre par rapports à d’autres technologies plus graves. Dans les réponses envoyées par les entreprises à la CNIL lors de sa consultation sur la VSA, on retrouve beaucoup de ces éléments de langage. Par exemple, l’entreprise francilienne Alyce affirme « qu’il ne peut y avoir de postulat de dangerosité » concernant la VSA, niant ainsi tous les dangers de l’usage des données biométriques pour faire de la surveillance. Elle reconnaît que beaucoup des systèmes de VSA présentent « un fort risque d’intrusion » mais tente de les hiérarchiser en précisant que « tous ne présenteront pas un niveau de risque fort, notamment selon le caractère identifiant des images captées, le niveau d’identification permise par la captation », et cite comme exemple les dispositifs en différé ou bien ceux sur les axes routiers « car notamment insusceptible de révéler des données sensibles ». Rappelons pourtant que la surveillance des axes routiers et notamment la LAPI (le type de VSA qui permet la lecture automatisée des plaques d’immatriculation) fournit un identifiant unique rattachable à l’identité civile du conducteur du véhicule.
De la même manière, l’entreprise Veesion (qui fait de la détection de vol) minimise sa technologie en la comparant à d’autres dans sa présentation : « La technologie de Veesion se fonde uniquement sur un traitement algorithmique de la gestuelle et des attitudes. L’entreprise n’utilise donc ni la reconnaissance faciale, ni le suivi de client, ni l’enregistrement d’identité ».
Ces stratégies se révèlent souvent assez efficaces. Le choix de faire de la reconnaissance faciale un épouvantail attirant toute la lumière, alors que c’est surtout la VSA qui est au cœur du texte de la loi Olympique, a déteint jusqu’au gouvernement, qui a précisé au paragraphe III de l’article 7 que l’expérimentation n’incluait pas la reconnaissance faciale. La présidente CNIL a également foncé dans le piège en soutenant que l’exclusion de la reconnaissance faciale était une garantie.
L’urgence pour l’heure n’est pas de parler de la reconnaissance faciale mais de visibiliser les conséquences de la VSA, au cœur de l’article 7 de la loi : la reconnaissance faciale est massivement rejetée par la population car ses dangers sont connus, c’est beaucoup moins le cas de la VSA qui comporte pourtant des dangers similaires. Il est essentiel de faire connaître cette technologie et de manifester notre opposition. N’hésitez pas à appeler les député·es (on vous explique comment faire ici) pour leur faire prendre conscience de la gravité du texte qu’ils sont en train de voter.
L’opportunisme : saisir chaque événement ou actualité pour promouvoir la surveillance biométrique
Conscients qu’avec un espace de débat ouvert sur le temps long, les mesures d’augmentation de la surveillance seraient fortement rejetées par la population, les promoteurs de la surveillance biométrique se servent de toutes les occasions possibles leur permettant de précipiter sa légalisation. C’est une stratégie à laquelle nous sommes fréquemment confrontés : l’épidémie de covid-19 a par exemple été prétexte à l’usage de drones, à la mise en œuvre du suivi de nos déplacements et à une accélération de la collecte des données de santé.
L’événement ici instrumentalisé, les Jeux olympiques, a déjà servi par le passé à l’extension de la surveillance. Par exemple, pour les JO de Tokyo, le gouvernement japonais a fait passer une loi « anti-conspiration » voulue de longue date pour mater les groupes militants et syndicaux, et fortement critiquée notamment par les Nations Unies au regard des atteintes aux libertés qu’elle créait et aux pouvoirs de surveillance qu’elle conférait à l’État. Plus récemment, le Qatar a mis en place un grand système de surveillance des personnes assistant à la Coupe du monde de football en 2022.
L’avantage, en termes d’acceptabilité, de se servir d’un événement exceptionnel comme les Jeux olympiques est de venir renforcer le sentiment d’éphémère et d’expérimentation. Dans les réponses à la CNIL, on retrouve l’échéance de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux de Paris 2024 dans quasiment toutes les bouches, comme par exemple celle de Deveryware (page 4), la RATP (page 13) ou encore la SNCF (page 3).
Autre opportunisme que l’on croise très fréquemment dans la technopolice : celui des débouchés économiques. Pour le secteur, le développement des technologies créerait de l’emploi et favoriserait la croissance économique du marché de la surveillance. Aussi, celui-ci doit exister en France pour se positionner face à la concurrence internationale, qui apparaît inéluctable.
Ainsi, l’ancien député Jean-Michel Mis clame la « souveraineté » du marché et pour le réseau Alliance pour la Confiance Numérique (représentant un certain nombre d’entreprises de vidéosurveillance), la CNIL doit « favoriser l’émergence de leaders français de l’intelligence artificielle de confiance et non pas aboutir à des règles ou des situations qui pourraient entraver leurs développements à la faveur d’acteurs non souverains ». Pour Deveryware, « les industriels ont pour mission de créer de la richesse pour la nation avec notamment l’objectif d’exporter leurs solutions » quand Veesion juge qu’un droit d’opposition trop contraignant exposerait « les entreprises du secteur à être considérées comme illégales et donc à arrêter l’ensemble de leurs activités. Cela conduirait à menacer, de manière immédiate, 500 emplois directs en France. »
De nouveau, cette stratégie parvient à ses fins puisqu’elle a été reprise par le ministre de l’Intérieur lui-même pendant les débats sur le projet de loi au Sénat le mois dernier : « Lorsqu’un dispositif est développé avec un cadre français, nous pouvons parler aux industriels, gérer en partie leurs actions, les réguler, regarder leur capital. Soyons fiers des entreprises françaises ! »
L’euphémisation : mettre en avant les usages les moins inquiétants
Les algorithmes utilisés dans la surveillance biométrique ont des applications bien plus larges que l’analyse des seuls corps humains. Si l’on prend l’exemple de la VSA, les algorithmes de « computer vision » peuvent très bien être utilisés sur des images ne contenant pas d’activité d’humaine, et n’utilisant donc pas de données biométriques, comme par exemple pour détecter des produits défectueux au bout d’une chaîne de fabrication.
Une stratégie particulièrement mise en avant par les promoteurs de la surveillance biométrique est alors de la rapprocher d’autres usages qui semblent beaucoup moins problématiques. Ils mettent généralement en avant les situations où l’activité humaine est la moins perceptible : repérer des ordures déposées sur des trottoirs ou des bagages abandonnés par exemple. Étant donné que l’objet de la détection n’est pas humain, il est facile de prétendre qu’il s’agit là d’une détection similaire à la détection d’anomalie dans une chaîne de production et de faire fi du fait que, pour aboutir à cette détection, l’algorithme sonde continuellement les flux vidéo de la rue, ou de l’espace public ou se retrouve déposé l’objet. Avec cette technique, les entreprises se gardent bien de faire comprendre que, même pour repérer un objet, les humains sont analysés en permanence.
Ainsi, pour justifier le bon usage de la VSA, l’AN2V mentionne des traitements ne « disposant d’aucun algorithme permettant de détecter des personnes : détection d’animal errant, mesure des traversées d’animaux, ouverture automatique d’une borne sur une rue piétonne sur détection d’un véhicule d’urgence, affichage d’un message ou commande d’un dispositif (feu rouge, borne) sur mesure de vitesse, etc. ». Pour la RATP, « l’amélioration de la puissance d’analyse d’un système de vidéoprotection ne dénature ni ne change la portée de la vidéo [exploitée] depuis de nombreuses années » car dans tous les cas, « que la détection soit d’origine humaine ou algorithmique », l’action des service de police ou de la RATP, serait « identique ».
Autre exemple, quand le maire de Nice laissait croire l’année dernière que le système de VSA qu’il souhaitait mettre en place ne traitait que des données « générales » et non biométriques (ce qui est faux), afin de minimiser ce que faisait réellement l’algorithme.
Les entreprises ont aussi recours à des jeux rhétoriques et des périphrases. La ville d’Orléans a par exemple tenté de faire passer l’audiosurveillance algorithmique implantée dans ses rues par la société Sensivic pour un simple « détecteur de vibration de l’air ». Cette technologie, en réalité basée sur la pose de microphones couplés à un logiciel d’analyse algorithmique, fonctionne comme la VSA et la reconnaissance faciale sur de l’analyse de l’activité humaine afin de repérer des cris ou divers bruits. La ville d’Orléans tentait par cette pirouette de faire oublier que cette surveillance était basée sur de l’analyse de données personnelles, et comptait ainsi échapper au RGPD. De la même manière, l’AN2V mentionne des « détections d’anormalité sonore » ou des « signatures sonores », tant de mots techniques destinés à camoufler que l’on parle de la mise sur écoute des personnes.
La neutralisation de la technologie
Une autre rhétorique que l’on a beaucoup rencontrée à La Quadrature est, lorsque l’on dénonce l’usage d’une technologie renforçant la surveillance, de s’entendre rétorquer que cet outil aurait un soi-disant caractère neutre et impartial. Les technologies sont alors présentées comme de simples aides techniques, des logiciels sans conséquence.
Concernant la VSA, la stratégie consiste alors à mettre en avant la décision finale de l’humain et à présenter le logiciel comme une simple « aide à la décision » ayant une fonctionnalité de « levée de doute ». Les entreprises insistent alors sur le fait que la véritable décision serait, elle, prise par l’humain au bout de la chaîne, et que la technologie ne serait qu’un outil neutre n’orientant le résultat de la surveillance d’aucune manière.
Par exemple, pour l’ACN, « cette technologie peut aider à la détection de situations pouvant conduire à une infraction, mais ne prend pas, à date, de décision finale automatisée. C’est une simple aide à la décision qui laisse la liberté à l’homme de contrôler/confirmer/infirmer ». Même chose chez l’Agora (un club de directeurs de la sécurité), « ces signalements sont alors validés ou non par une action humaine. La technologie utilisée dans ce cadre intervient donc en amont, en tant que support de l’action humaine » ou l’AN2V : « Seul le regard et l’interprétation humaine envisage ou non une action ou une procédure. On est là dans un cas d’aide à la décision ».
En réalité, ce travail de « détection de situations » réalisé par le logiciel présuppose d’avoir choisi en amont, d’une part, les événements pertinents à relever et, d’autre part, les critères pertinents pour détecter et retrouver ces évènements sur une image. Ainsi, de nombreuses décisions impactantes et révélant des choix politiques et moraux surviennent au cours du processus de construction de ces algorithmes. En effet, de façon identiques à ce que nous dénoncions pour la CAF, les algorithmes fonctionnent en traduisant et imitant des décisions et subjectivités humaines, contenues jusqu’au sein même des jeux de données qui sont fournis aux algorithmes pour l’apprentissage. Rien n’est neutre dans la VSA.
Conclusion
Au final, toutes ces stratégies ont une conséquence : dépolitiser la surveillance, en faire un objet banal et inéluctable, masquer sa véritable nature. On aimerait en rire mais que dire lorsque l’on voit que certaines entreprises comme Veesion ou l’ACN regrettent le caractère « anxiogène » de l’analyse de la CNIL quand elle évoque la versatilité des technologies ou le « changement de nature et de portée » des caméras ? Ou quand la SNCF exige de cette même CNIL qu’elle apporte preuves et études lorsqu’elle ne fait que relever « la dangerosité des technologies de [VSA] » et évoque le « sentiment de surveillance généralisée » ?
Ce déni de ce que représente la surveillance, de ce qu’elle a causé dans l’Histoire, des raisons pour lesquelles on a cherché à la limiter il y a cinquante ans, est vertigineux. La surveillance a été et sera toujours un instrument de pouvoir pour les États. Nier que la collecte, l’organisation et la rationalisation d’informations sur une population est source de contrôle pour qui les détiennent est une manœuvre non seulement cynique mais aussi dangereuse et révélatrice de la perte de repères politiques d’un grand nombre d’acteurs. Car on pourrait ne pas être surpris que ces pratiques éhontées viennent d’entreprises capitalistiques qui n’ont d’autre but que de faire du profit (et encore). Mais que dire lorsque l’on retrouve l’ensemble de ces stratégies et discours des industriels dans la bouche des ministres et des élus censés savoir que dans un État de droit qui se respecte, tout pouvoir étatique doit être contrôlé et limité ?
Nous nous battons depuis des années contre la surveillance abusive et le déploiement du contrôle de masse dans l’espace public. Aujourd’hui nous observons de façon inédite d’un côté la prégnance d’un marché tentaculaire de la sécurité, qui voit dans toute offre commerciale une occasion bonne à prendre, et de l’autre côté des gouvernants qui y répondent sans sourciller même si la demande n’existe pas et que les dangers sont réels. Ces manœuvres doivent être dénoncées. Car à mesure qu’elles s’installent comme des évidences, elles effacent de notre mémoire collective tous les exemples passés et présents de dérives du pouvoir étatique, de surveillance et de répression des populations. Elles participent à saper l’héritage des luttes démocratiques qui nous permettent de lutter contre les abus de pouvoirs et l’autoritarisme.
